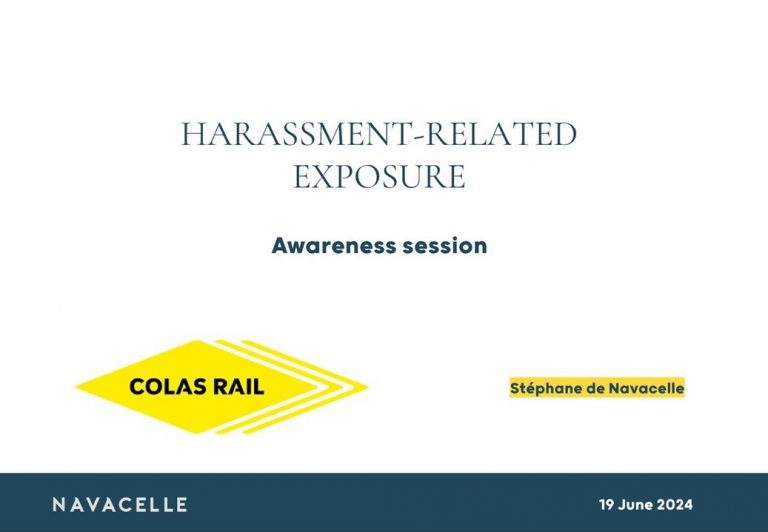I. Compliance environnementale : un concept récent répondant à une prise de conscience actuelle
Lors du lancement de l’Agence française pour la biodiversité le 13 février 2020, le président Emmanuel Macron a qualifié les préoccupations environnementales de défi du siècle, et a appelé les différents acteurs de l’économie à respecter les engagements environnementaux[1]. L’environnement est défini largement par l’article L110-1 du code de l’environnement comme “les ressources, les espaces naturels, la biodiversité marine et la vie terrestre, les paysages, la qualité de l’air et la vie en elle-même.”
Bien que le principe 25 de la Déclaration de Stockholm de 1972 dispose expressément que les principaux acteurs du respect de l’environnement sont les Etats et les organisations internationales, ce n’est que récemment que la législation relative à l’environnement a commencé à faire la une des journaux en France.
En effet, il a fallu plusieurs catastrophes écologiques d’origine humaine pour que la France prenne en compte l’environnement dans sa législation[2]. Aujourd’hui, il existe plus de 1000 accords multilatéraux et bilatéraux sur diverses préoccupations environnementales[3]. Le 1er mars 2005, la France a intégré la Charte de l’environnement dans son droit interne, en particulier au sein du bloc de constitutionnalité[4]. Un tel cadre législatif illustre une prise de conscience croissante des menaces existantes pour la planète.
D’autre part, la compliance peut être définie comme le besoin de se conformer à une règle, une politique, une norme ou une loi. Elle vise également à empêcher la réalisation d’un risque. Le terme juridique de “compliance” a été popularisé en France par la loi Sapin II[5], un concept qui a été transformé en un outil stratégique pour les entreprises, et ce indépendamment de leur domaine d’activité.
C’est sur ce point que les préoccupations en matière de compliance et d’environnement peuvent se rejoindre. La compliance est une exigence générale de “bonne conduite” de la part des agents économiques. Elle exige également une évaluation de l’exposition aux risques de sanctions administratives ou pénales ainsi qu’aux atteintes à la réputation[6]. Dans les deux cas, l’objectif est de limiter le risque d’atteinte à l’environnement. Les institutions publiques et privées qui voudraient fermer les yeux, se voient rappeler à plusieurs reprises leurs « devoirs » par les autorités de contrôle et de surveillance.
En outre, l’idée est de dire que d’une certaine manière, la compliance englobe les préoccupations environnementales. Les activités relevant du droit de l’environnement présentent souvent un risque pour la santé, l’environnement ou la biodiversité, et sont par conséquent, soumises à l’octroi de licences ainsi qu’à des obligations d’enregistrement et de déclarations. La compliance est également assujettie aux règles de police administrative, ce qui implique que certaines activités économiques ne peuvent pas exister si elles ne respectent pas strictement les normes imposées[7].
Si l’efficacité d’une norme découle souvent de la capacité à sanctionner tout manquement, la compliance se présente également comme une solution, en encourageant les entreprises à prendre part à leur propre règlementation et à prévenir les comportements à risque. En ce sens, la loi Sapin II sur la lutte contre la corruption[8] est certainement l’un des meilleurs exemples de la manière dont la compliance a été intégrée en France comme outil stratégique contraignant dans les politiques internes des entreprises.
Cependant, l’efficacité de la compliance environnementale doit encore progresser en France.
II. L’absence d’un cadre général pour le respect de l’environnement
La plupart des principes de compliance environnementale font partie d’un corpus de droit souple, largement basé sur des engagements volontaires et non contraignants.
Parmi eux, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est intégrée dans les normes ISO 26000:2010, les premières normes de ce type sur la responsabilité sociale internationale[9]. La RSE exige la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales par les entreprises[10]. La France a été pionnière dans l’adhésion à la RSE puisque la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) de 2001 encourageait déjà les sociétés cotées en bourse à se comporter comme des “entreprises citoyennes”. On leur demandait en effet de publier dans leurs rapports annuels des informations sur les mesures prises concernant l’impact environnemental et social de leurs activités[11]. Cette obligation de déclaration a ensuite été renforcée par la loi Grenelle I, la loi Grenelle II[12], mais aussi par l’ordonnance du 19 juillet 2017[13]. Toutes les entreprises de plus de 500 salariés doivent désormais introduire dans leur rapport annuel de gestion des informations extra-financières “relatives aux conséquences de leurs activités, de l’utilisation et de la production de biens et de services sur le changement climatique, à l’engagement social en faveur du développement durable, à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage alimentaire”. De même, la loi PACTE[14] a récemment créé une nouvelle disposition dans le code civil français, prévoyant que “les sociétés sont gérées dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités [15]”.
Le 27 mars 2017, la France a franchi une étape supplémentaire en introduisant un devoir de vigilance pour les sociétés mères et les entreprises sous-traitantes établies en France et employant plus de 5000 salariés en France ou 10000 salariés à l’étranger[16]. Elle a créé une obligation pour les sociétés mères et les entreprises sous-traitantes d’identifier et de prévenir les atteintes aux droits de l’homme et les dommages à l’environnement résultant non seulement de leur propre activité mais aussi de celle des entreprises sur lesquelles elles exercent un contrôle direct ou indirect, ou de celle de leurs sous-traitants et fournisseurs français ou étrangers[17]. Elle exige notamment la mise en œuvre d’une cartographie des risques, qu’elles prennent les mesures appropriées pour réduire les risques, la prévention les infractions et la mise en place de procédures régulières pour évaluer la situation de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. Sur cette base, une entreprise multinationale peut être tenue responsable des dommages causés à l’environnement par son activité ainsi que par celles de ses filiales, sous-traitants et fournisseurs.
Si cette loi constitue une “étape majeure afin d’assurer que les droits de […] l’environnement sont respectés par les multinationales”, des écueils ont néanmoins été identifiés, parmi lesquels : l’exclusion de certaines entreprises exerçant une activité à risque en raison du seuil élevé de salariés requis pour la mise en œuvre du devoir de vigilance ; la charge de la preuve restant à la charge du demandeur et l’absence de sanctions pénales[18].
Sur ce point, il était initialement prévu que soit mis en place un mécanisme de sanctions par lequel l’entreprise aurait dû compenser tout dommage résultant de la violation du devoir de vigilance par une amende pouvant atteindre les 10 millions d’euros, susceptible d’être triplée en fonction de la gravité de la faute[19]. Cette disposition a toutefois été invalidée par le Conseil constitutionnel en raison de l’imprécision et de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines[20].
En outre, un an après l’entrée en vigueur de la loi, le 27 mars 2017, il apparaît que ses objectifs n’ont été que partiellement atteints et qu’un certain nombre d’entreprises n’ont publié que des informations limitées sur leurs initiatives environnementales, malgré l’obligation d’y procéder[21].
Par conséquent, bien que la France dispose d’un cadre juridique assez large en matière de compliance environnementale, celui-ci doit encore être amélioré, notamment par la mise en œuvre de sanctions et de contrôles.
III. Soutenir la compliance environnementale grâce au droit pénal de l’environnement et à des outils de mise en œuvre efficaces
Nonobstant l’existence de sanctions administratives et pénales visant à garantir le respect effectif des exigences en matière de compliance environnementale[22], il n’existe pas d’incrimination générale et unique pour les dommages causés à l’environnement. Ainsi, la diversité des activités et des sources (pénales/administratives ; droit dur/souple) et l’absence d’harmonisation sont souvent considérées comme une “menace virtuelle” pour les entreprises, le manque de clarté compliquant la mise en œuvre de sanctions pour les autorités[23].
Début 2019, un groupe de députés socialistes français a proposé de faire voter un crime “d’écocide” comme nouveau crime contre l’environnement, faisant écho au concept de génocide. Ce crime aurait été défini comme “l’exécution d’une action coordonnée destinée à la destruction ou à la détérioration totale ou partielle d’un écosystème en temps de paix ou de guerre, l’atteinte grave et durable à l’environnement et aux conditions de vie d’une population[24]”, et aurait été sanctionné par 20 ans d’emprisonnement, tout en étant imprescriptible. Le Sénat et le gouvernement français ont finalement rejeté le projet en reprochant à la loi son manque de clarté[25].
Le rejet du projet de loi a cependant lancé le débat sur la nécessité de parfaire les dispositions pénales françaises en matière d’environnement. En conséquence, le 3 mars 2020, le Sénat français a adopté en première lecture une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale aux atteintes à l’environnement[26]. Cette réforme proposait de créer trois niveaux de réponse aux atteintes à l’environnement, en fonction de la gravité et du type d’atteinte, avec des juges dédiés au sein des juridictions[27].
Dans le cadre de cette réforme, un “accord de poursuites différées en matière environnementale” (DPA), basé sur le modèle mis en œuvre par la loi Sapin II pour les délits de probité (la Convention Judiciaire d’Intérêt Public ou CJIP) serait également introduit[28]. Ce mécanisme viserait à renforcer le droit pénal à un point tel qu’“il ne serait plus économiquement intéressant de causer un dommage environnemental[29]”.
Modèle de justice négociée, la CJIP est reconnue pour son succès croissant en France depuis son entrée en vigueur et devrait être adaptée à la complexité des questions et législations environnementales. En effet, rapporter la preuve des infractions environnementales, et en particulier le lien de causalité, est souvent difficile[30]. Afin de pallier à ces difficultés, la CJIP environnementale permettra de sanctionner les atteintes graves à l’environnement en incitant les entreprises contrevenantes à collaborer au lieu d’être condamnées.
En contrepartie, les entreprises devront payer une amende proportionnelle au bénéfice tiré de la faute, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entité au titre des trois années précédant l’infraction[31]. Il pourra également être imposé à l’entité de réparer les dommages causés dans les trois suivants suivant l’accord, d’indemniser les victimes identifiées dans l’année suivant ledit accord et, surtout, de mettre en œuvre un programme de compliance sous le contrôle du ministère de l’Environnement[32].
Le contenu des programmes de compliance reste à déterminer. Il pourrait être basé sur les procédures internes prévues pour les questions de corruption, telles qu’une procédure de signalement, la mise en œuvre d’un code de conduite et la cartographie des risques[33].
Les organisations non gouvernementales ont toutefois exprimé leur crainte d’être exclues du débat[34]. De telles dispositions pourraient limiter l’impact des sanctions et négliger l’aspect éducatif primordial sur ces questions environnementales.