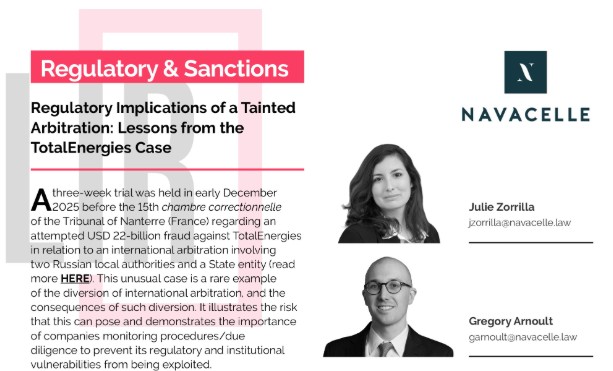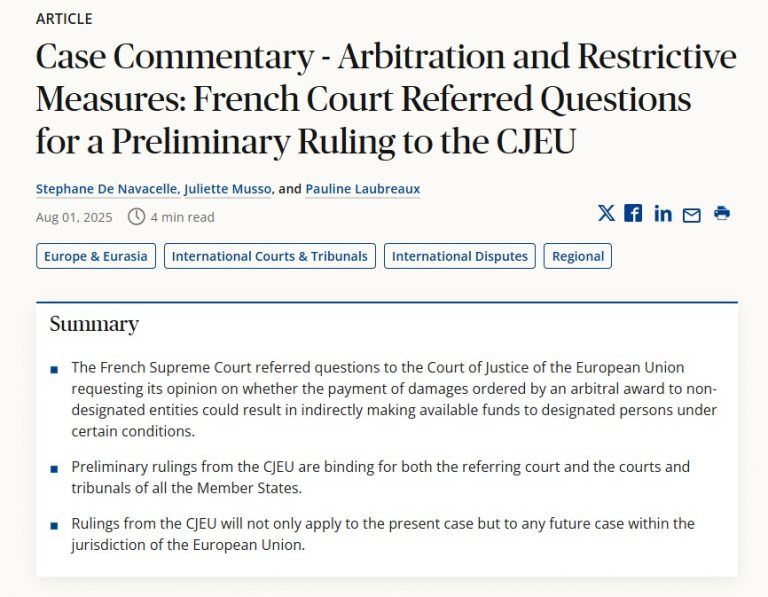La jurisprudence rendue en droit de l’arbitrage au cours de l’année écoulée a une nouvelle fois été riche, notamment en produisant des arrêts spécifiquement liés au traitement d’allégations de fraude et de corruption au stade du contrôle de la sentence ainsi qu’à la prise en compte de sanctions internationales dans le cadre de l’exécution de la sentence.
I. Une partie qui, sans motif légitime, s’abstient de soulever en temps utile des moyens relatifs à un certain type de fraude alléguée dans la formation et l’exécution du contrat objet du litige, est présumée avoir renoncé à s’en prévaloir
Afin d’éviter qu’un plaideur ne se réserve des arguments pour ralentir la procédure arbitrale ou encore faire annuler la sentence en résultant si l’issue de l’arbitrage ne lui est pas favorable, les moyens soulevés trop tardivement sont généralement irrecevables. A titre d’exception, certains arguments, même soulevés hors délai, demeurent recevables car ils visent à protéger certains intérêts volontiers qualifiés de “supérieurs”. Ainsi en est-il, par exemple, de la corruption. Une sentence peut toujours être annulée au motif que son maintien permettrait de tirer des bénéfices d’un pacte corruptif, qu’importe que la corruption reprochée n’ait pas été évoquée auparavant, notamment durant l’arbitrage.
Cependant, déterminer si des arguments sont susceptibles de relever de cette exception constitue un exercice particulièrement complexe..
Par un arrêt rendu le 21 janvier 2025 (n° 23/05511), la cour d’appel de Paris s’est notamment penchée sur cette question et apporte quelques précisions intéressantes.
La cour s’est prononcée sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue le 26 février 2023 dans un litige opposant la Banque Centrale d’Irak (“BCI”) à la société Cardno Middle East Limited (“Cardno”)[1]. Le différend à l’origine de cette sentence portait sur l’exécution d’un contrat de conseil concernant la construction du nouveau siège de la BCI à Bagdad[2]. A la suite de défauts de paiements de la BCI, Cardno a engagé une procédure d’arbitrage administrée par la Chambre de commerce internationale (“CCI”) et dont le siège était à Paris, ce qui entraînait l’application du droit français de l’arbitrage international.[3] Le tribunal arbitral, composé d’un arbitre unique, a condamné la BCI à, entre autres, verser à Cardno le montant des factures impayées et des dommages et intérêts[4].
La BCI a formé un recours en annulation, arguant notamment que la reconnaissance de la sentence heurterait l’ordre public international en ce qu’elle permettrait à Cardno de bénéficier du produit d’actes délictueux et d’une fraude, et que la sentence serait entachée d’une fraude procédurale[5]. Plus précisément, la BCI soutenait que Cardno aurait obtenu le contrat de consultance frauduleusement – en dissimulant son manque d’expérience et sa non-affiliation à une société reconnue, la société Cardno International – et que l’exécution de ce contrat serait également entachée de fraude – notamment en facturant des prestations de service fictives[6]. En défense, Cardno a opposé l’irrecevabilité de cet argument, sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile français disposant qu’une partie qui ne soulève pas en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir[7]. Selon Cardno, la BCI n’avait pas soulevé cet argument en temps utile devant l’arbitre, alors même que rien ne l’avait empêché de le faire[8].
Ainsi que rappelé ci-dessus, l’article 1466 souffre d’exceptions. C’est ainsi que Cardno s’est appuyé sur la distinction entre l’ordre public de fond, dont les parties ne peuvent disposer, et l’ordre public de protection, auquel les parties peuvent renoncer[9]. Ce faisant, Cardno espérait que le juge entérine une distinction entre divers types de fraude, celles qui doivent obligatoirement être soulevées en temps utile pour être recevables, et les autres.
En l’espèce, la cour juge que, si les allégations portaient sur des faits présentés comme frauduleux par la BCI – qualifiés par cette dernière de détournements de fonds publics, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, de blanchiment et d’usurpation d’identité et pouvant être qualifiés d’infractions en droit irakien[10] –, elles concernaient avant tout des actes affectant la formation ou l’exécution du contrat sous-jacent et des intérêts privés et partant, ne relevant pas de l’ordre public international[11]. Une distinction est ainsi opérée entre les faits de l’espèce, portant sur des intérêts privés, et des problématiques de fraude et de blanchiment en matière publique, plus classiquement considérées comme relevant de l’ordre public international. En particulier, et afin de distinguer ce qui relèverait de “moyens de droit et de fait dont [la BCI] peut librement disposer” de ce qui relèverait de l’ordre public international, la cour juge qu’il n’est pas fait état de corruption d’agents publics, que le détournement de fonds allégués concerne l’administration des intérêts privés de la BCI et serait du fait d’un opérateur privé[12].
La cour tente ainsi de restreindre le champ de l’ordre public international en le limitant à la protection des intérêts purement publics.
Constatant que la BCI avait une connaissance préalable des griefs allégués et qu’elle avait été en mesure de faire valoir sa position dans le cadre de la procédure arbitrale, la cour juge qu’elle a renoncé à se prévaloir de ce moyen, qu’elle déclare irrecevable[13].
Cet arrêt apporte des précisions intéressantes sur ce qui constitue un principe d’ordre public international dans le contexte d’allégations de fraude. Si la conclusion n’a pas totalement convaincu la doctrine[14], la cour opère une distinction entre les intérêts publics et les intérêts privés. Notons enfin que le débat n’est pas clos car la Cour de cassation sera probablement amenée à se pencher sur ces questions.
II. La portée des régimes de sanctions internationales en question dans le cas d’un paiement au titre d’une sentence internationale
Instrument central de politique étrangère et des relations internationales, les sanctions internationales ont par nature des effets de droit privé et des conséquences sur le commerce international[15]. Par exemple, l’interdiction d’importer du pétrole russe affecte évidemment toute personne soumise à cette interdiction et qui se fournissait jusqu’alors auprès de producteurs russes via des contrats à long terme. Celle-ci doit suspendre l’exécution de tout contrat qu’elle avait avec ces fournisseurs et risquer d’affronter des procédures judiciaires ou arbitrales pour rupture de contrat.
Il n’est donc pas étonnant de voir les sanctions mobilisées dans le cadre de procédures arbitrales ou encore de l’exécution de sentences arbitrales. La tension entre la nature publique et privée de ces instruments a ainsi fait l’objet de développements jurisprudentiels récents dont le présent arrêt constitue un nouveau jalon.
Dans l’affaire en question, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans un litige opposant les sociétés DNO Yemen, Petrolin Trading et MOE Oil & Gas Yemen (“MOE”) à l’État du Yémen et l’entreprise publique Yemen Oil & Gas Corporation (“YOGC”), dans le cadre d’un projet pétrolier et gazier au Yémen[16]. A la suite de désaccords dans l’exécution des contrats, les parties étatiques ont introduit une procédure arbitrale ayant abouti à la condamnation de DNO Yemen, Petrolin Trading et MOE[17]. Ces dernières ont formé un recours en annulation, arguant que la sentence bénéficierait indirectement à des entités faisant l’objet de sanctions internationales, notamment le règlement (UE) n° 1352/2014 du 18 décembre 2014 qui prévoyait dans sa version du 8 juin 2015, en son article 2.2, que “nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I [qui contenait à cette date un certain nombre de dignitaires et commandants houthis], ou utilisés à leur profit”.
Dans son arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a examiné en détail la portée de ces sanctions pour déterminer si, au moment de sa décision et sur la base d’éléments “sérieux, précis et concordants”, la reconnaissance ou l’exécution de la sentence n’était pas susceptible de violer les sanctions en fournissant directement ou indirectement des actifs à des personnes ou des entités figurant sur la liste des sanctions. Elle a ainsi déterminé que le Ministère du Pétrole et des Minéraux de la République du Yémen et YOGC n’étaient pas concernés par les sanctions et a rejeté le recours[18].
Au soutien de leur pourvoi, les demanderesses reprochent à la cour d’appel d’avoir rejeté leur recours en limitant la portée de l’article 2.2 du règlement (UE) n° 1352/2014. En particulier, elles reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les bénéficiaires de la sentence n’avaient pas pour intention de mettre à disposition les dommages et intérêts obtenus à des personnes sanctionnées ; qu’importe à cet égard que ces dernières n’exercent pas de contrôle ou n’instruisent pas les bénéficiaires de la sentence. Autrement dit, elles reprochent à la cour d’appel une mauvaise grille d’analyse.[19].
Sur cette question, la Cour de cassation, confrontée à l’interprétation du droit de l’Union européenne, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (“CJUE”) de questions préjudicielles. Elle a notamment interrogé la CJUE sur la portée de la notion de “mise à disposition indirecte” de fonds dans le cas d’un paiement en exécution d’une sentence arbitrale au bénéfice d’une entité au sein de laquelle il serait exercé une “influence concurrente”, à la fois de parties légitimes et de parties visées par les sanctions.[20] La Cour a également interrogé la CJUE s’agissant de la présomption de contrôle et le standard à appliquer dans ce cas[21].
Cet arrêt de la Cour de cassation devrait servir à délimiter plus précisément le rôle du juge du contrôle et la portée des sanctions internationales.
Dans une série d’arrêts récents[22], les juridictions françaises se sont attelées à examiner la portée des sanctions internationales dans la reconnaissance ou l’exécution de sentences arbitrales. Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans cette lignée et devrait servir à délimiter plus précisément le rôle du juge du contrôle et la portée des sanctions internationales. En outre, la question de la sanction appropriée en cas d’absence de conformité à l’ordre public international peut se poser dans ce contexte. En effet, l’annulation d’une sentence arbitrale, qui a un effet définitif, est-elle proportionnée, alors que la sanction internationale a, par définition, vocation à être temporaire ? Il a pu être ainsi suggéré que le refus d’exequatur, plus souple et réversible, pourrait constituer une alternative plus adaptée[23].
III. La reconnaissance d’une sentence ne viole pas l’ordre public international en l’absence d’indices graves, précis et concordants d’actes de corruption
Dans un arrêt du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Paris s’est, une nouvelle fois, penchée sur l’examen d’allégations de corruption affectant les contrats objets de la sentence arbitrale. Cet arrêt, qui s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, permet de rappeler les principes encadrant le contrôle de la sentence dans le cadre d’allégations de corruption.
Le litige portait sur l’exécution d’un protocole d’accord visant à résoudre, à l’amiable, un différend concernant un contrat de fourniture et d’exploitation d’une plateforme de contrôle du trafic de télécommunications entre la République du Tchad et la société N-Soft Ltd (“N-Soft”)[24]. Le protocole d’accord prévoyait la résiliation du contrat et le paiement par le Tchad d’un montant de 25 millions d’euros à N-Soft[25]. En l’absence de paiement, N-Soft a introduit une procédure arbitrale selon le règlement de la Cour commune de justice et d’arbitrage (“CCJA”) et dont le siège était à Abidjan. La sentence rendue le 23 mai 2022 a condamné le Tchad au paiement, notamment, des 25 millions d’euros dus au titre du protocole d’accord[26].
Pour contester l’exequatur en France de la sentence, le Tchad a invoqué une atteinte à l’ordre public international, alléguant d’actes de corruption ayant entaché la conclusion du contrat de fourniture et d’exploitation, et du protocole d’accord. Plus précisément, le Tchad faisait état, dans le cadre de la conclusion du contrat, du versement de commissions versées à des agents publics pour des prestations dont la réalité n’était pas établie[27]. Il faisait également état, s’agissant du protocole d’accord, de l’absence de négociation, de contreparties déséquilibrées et de sa signature par un ministre non habilité à cet effet[28].
La cour, dans la continuité de sa jurisprudence sur le sujet, rappelle tout d’abord que son contrôle s’attache à vérifier que l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique français n’aurait pas pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit de cette corruption. Pour ce faire, la Cour cherche à identifier des indices graves, précis et concordants[29]. Elle ajoute en outre que cette recherche probatoire ne se limite pas aux éléments produits dans le cadre de la procédure arbitrale[30]. Partant, la cour procède à une analyse factuelle détaillée. A cet égard, et comme exposé ci-dessus au sujet de l’affaire Cardno, qu’importe que les allégations de corruption n’aient pas été soulevées devant l’arbitre puisqu’il est ici question d’ordre public international.
La cour examine en premier lieu les allégations de corruption entourant la conclusion du contrat, notant que, s’il apparaît que des intermédiaires aient été rémunérés par N-Soft, le Tchad ne parvient pas à apporter la preuve de ce que ceux-ci aient été des agents publics[31]. La cour relève également que la rémunération de ces intermédiaires, si elle apparaît élevée, n’était pas dénuée de contrepartie[32]. Enfin, la cour s’appuie sur une ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre d’une procédure au Tchad, mettant hors de cause les intermédiaires[33].
La cour se penche ensuite sur le protocole transactionnel, notant tout d’abord que ses termes ont fait l’objet de négociations entre les parties[34]. La cour examine l’équilibre contractuel du protocole d’accord et sa logique sous-jacente pour conclure qu’il n’est pas dénué de “toute justification juridique ou économique, ou qu’[il] irait à l’encontre de[s] intérêts [du Tchad]”[35]. Enfin, la cour relève que la validité du protocole d’accord n’a pas été remise en cause, de sorte que sa signature irrégulière est insuffisante pour indiquer qu’il serait entaché de corruption[36].
La cour aboutit à la conclusion que “la preuve de l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants d’actes de corruption […] n’est pas rapportée”[37], démontrant une certaine exigence dans le niveau de preuve à apporter s’agissant d’allégations de corruption visant à éviter l’exécution d’une sentence arbitrale en France.