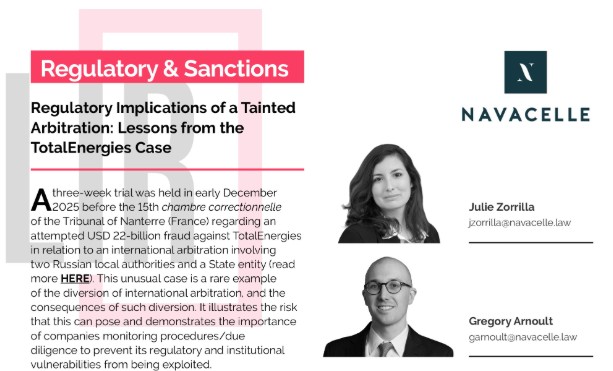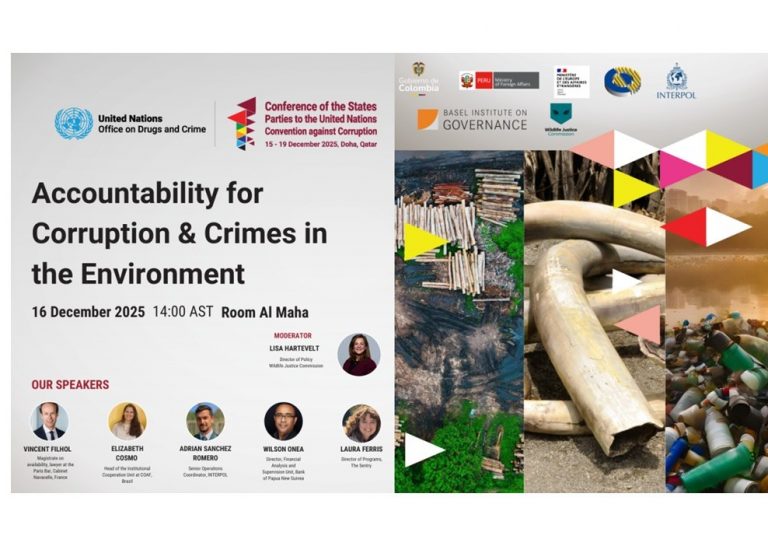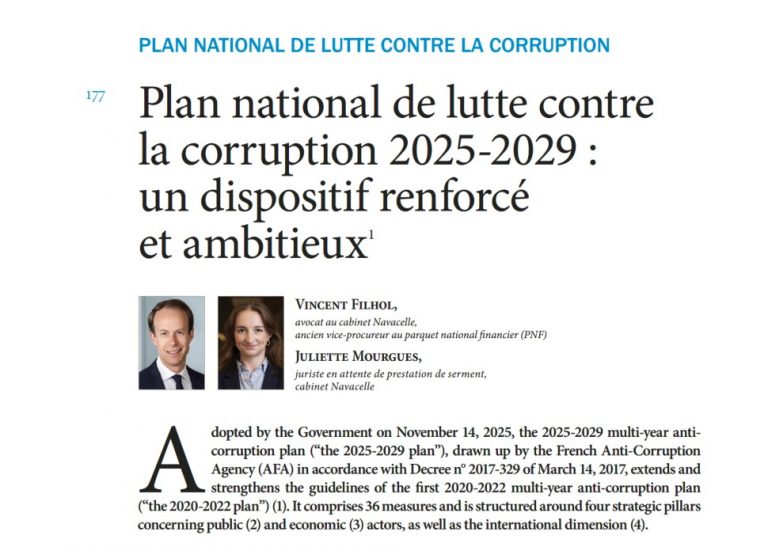La lutte contre les atteintes à la probité progresse encore en France, notamment sur le plan judiciaire où les procès correctionnels se sont faits nombreux et médiatiques. Il en est de même concernant la lutte anti-blanchiment où la réglementation nationale s’étoffe et où les déclarations de soupçons se font plus nombreuses. Plus largement, la jurisprudence a consacré la notion de harcèlement moral institutionnel et s’est prononcée sur d’autres notions procédurales dans des procédures de droit pénal des affaires.
La lutte contre les atteintes à la probité se renforce entre procès médiatiques et analyses du phénomène corruptif pour mieux y remédier
Au cours des douze derniers mois, la lutte contre les atteintes à la probité s’est manifestée notamment d’un point de vue répressif, par quelques décisions judiciaires d’importance, et du point de vue de la sensibilisation, par de nouvelles initiatives de l’Agence Française Anticorruption (AFA).
En matière de répression de ces atteintes, le nombre de Conventions Judiciaires d’Intérêt Public (CJIP) a diminué par rapport à la tendance des années passées, puisque seules 4 conventions relatives à ces atteintes ont été signées depuis juillet 2024.
Pour aller plus loin :
- Observatoire des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public
- CJIP Areva SA / Orano Mining
- CJIP Paprec : retour sur la répression pénale en cas de violation des règles d’attribution des marchés public
- CJIP Klubb pour des faits de corruption d’agent public étranger indépendamment de l’absence d’identification formelle dudit agent
En revanche, de nombreuses affaires d’atteintes à la probité ont été médiatisées et largement commentées.
C’est ainsi que le procès concernant notamment le détournement de fonds publics par des députés européens du Front National (devenu depuis Rassemblement National), et celui pour corruption passive et financement illégal de campagne électorale en raison des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, ont été largement couverts médiatiquement.
Pour aller plus loin : Un an de justice pénale : les grands procès pénaux de juillet 2024 à juillet 2025
La chambre criminelle de la Cour de cassation a également tranché dans une autre affaire très médiatique le 18 décembre 2024, en rendant définitive la condamnation pour corruption et trafic d’influence de Nicolas Sarkozy dans l’affaire dite des écoutes. Il s’agit là de la première condamnation d’un ancien Président sous la Ve République.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait retenu le 17 mai 2023 la culpabilité de l’ancien Président de la République pour avoir noué en 2014, au côté de son conseil, Maître Thierry Herzog, ce qu’elle avait qualifié comme un pacte de corruption avec un haut magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Ce dernier devait transmettre des informations et influer sur un recours formé par Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bettencourt, en échange d’un poste à Monaco. La Cour de cassation a ainsi confirmé la condamnation de l’ancien Président à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an ferme sous bracelet électronique, assortie d’une peine complémentaire d’inéligibilité d’une durée de trois ans.
Ce qui mènera vraisemblablement la Cour à devoir se prononcer sur l’étendue du secret professionnel de l’avocat
En sus de venir alimenter le contentieux en matière de probité, ce dossier a fait l’objet d’un fort intérêt puisqu’il traitait de la question du secret professionnel de l’avocat. En effet, la procédure pénale ayant servi aux poursuites ne reposant que sur des écoutes téléphoniques des échanges passés entre l’ancien Président sous l’identité de Paul Bismuth, et son conseil, ces derniers avaient alors argué du fait que leurs échanges étaient couverts par le secret professionnel de l’avocat. Tous les niveaux de juridiction ont considéré dans leurs décisions respectives que ce n’était pas le cas.
Nicolas Sarkozy a annoncé par la voix de son conseil saisir la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation du droit à un procès équitable, ce qui mènera vraisemblablement la Cour à devoir se prononcer sur l’étendue du secret professionnel de l’avocat.
Pour aller plus loin : Affaire des écoutes : condamnations définitives de l’ancien Président de la République, son avocat et un magistrat français
Pour améliorer la lutte contre les atteintes à la probité, l’AFA a, par application d’un arrêté du 20 novembre 2024, vu son organisation évoluer pour qu’elle s’articule désormais autour de deux sous-directions, l’une pour les acteurs économiques et l’autre pour les acteurs publics. Cette réorganisation a pour but de préciser au mieux les accompagnements faits et les conseils donnés aux acteurs, prenant en compte leurs spécificités et les enseignements tirés des contrôles réalisés. Elle s’accompagne en sus de la création d’un observatoire des atteintes à la probité, lequel a “vocation à produire des analyses sur le phénomène corruptif et à valoriser les bonnes pratiques”. Il a également pour mission de mener des études générales ou sectorielles afin d’identifier les zones et facteurs des principaux risques auxquels s’exposent les acteurs, et ainsi mieux appréhender ces risques et leur remédiation.
“vocation à produire des analyses sur le phénomène corruptif et à valoriser les bonnes pratiques”
Dans le prolongement de cet appel à analyse des atteintes à la probité, l’AFA a publié le 9 décembre 2024 une note analytique des poursuites de ces atteintes, fondée sur l’examen de 504 décisions judiciaires rendues en 2021 et 2022.
Pour aller plus loin : Analyse par l’AFA des décisions de justice de première instance en matière d’atteinte à la probité sur les années 2021-2022
L’AFA a également organisé une conférence le 10 février 2025 intitulée “Contrôle des dispositifs anticorruption des entreprises – Stratégie et perspectives – 1er rendez-vous de l’AFA” permettant à sa directrice, Isabelle Jégouzo, de faire le bilan de l’ensemble des contrôles réalisés par l’agence depuis sa création, d’en tirer les principaux enseignements et de présenter la ligne stratégique décidée en conséquence pour l’année 2025. L’accent est ainsi mis sur les axes suivants :
- l’engagement de l’instance dirigeante
- la structuration de la gouvernance anticorruption
- l’importance de la cartographie des risques qui doit être précise et adaptée aux enjeux spécifiques de l’organisation dans laquelle elle est faite
- la cohérence entre les risques identifiés et les mesures décidées
- un réel suivi et une évaluation des dispositifs mis en œuvre pour s’assurer de leur efficacité.
Pour aller plus loin : Panorama des actualités de l’AFA en matière de lutte contre la corruption / atteintes à la probité
La lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT)
La réglementation nationale est renforcée dans le domaine par l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 qui transpose les évolutions de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme s’agissant des informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs. Par cette ordonnance, la réglementation française assujettit désormais à la LCB-FT les prestataires de services sur cryptoactifs fournissant exclusivement des services de conseil sur cryptoactifs.
Un renforcement des contrôles sur les cryptoactifs
Ce renforcement est également démontré par l’augmentation du nombre de déclarations de soupçon transmises par les professions assujetties au dispositif national de LCB-FT. En effet, dans son rapport d’activités 2024 publié le 13 juin 2025, Tracfin indique avoir reçu 211 165 déclarations de soupçon, soit 13% de plus qu’en 2023. L’un des objectifs désormais affirmé par Tracfin est d’améliorer la qualité de ces déclarations de soupçon, lesquelles doivent “énoncer la nature du soupçon sans se limiter à une énumération de faits ou d’opérations”. Pour ce faire, Tracfin annonce des échanges réguliers et des projets conjoints avec les professionnels déclarants.
Quelques jurisprudences d’intérêt
Parmi les décisions rendues ces derniers mois, il faut noter l’arrêt du 21 janvier 2025 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a reconnu que “les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel” entrent dans le champ de l’article 222-33-2 du code pénal. La Cour consacre ainsi la notion de harcèlement moral institutionnel définie pour la première fois par le jugement du tribunal de Paris prononcé le 20 décembre 2019, puis reprise dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 30 septembre 2022.
La décision du Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 21 mars 2025 est également intéressante en ce qu’elle écarte l’obligation de la notification du droit de se taire par les enquêteurs de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) lors d’opérations de visite. La question soumise au Conseil constitutionnel était en effet relative à la conformité à la Constitution de l’article L.621-12 alinéa 1er du code monétaire et financier, qui prévoit lors d’opérations de visite conduites par les enquêteurs de l’autorité la possibilité de procéder au recueil des explications des personnes sollicitées sur place, sans qu’une notification de leur droit de se taire aux personnes sollicitées n’ait lieu. Pour les requérants, une telle absence de notification porte nécessairement atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, notamment au droit de ne pas s’auto-incriminer dans le cadre d’une procédure répressive et au droit de se taire. A contrario, le Conseil constitutionnel a considéré que la notification du droit de se taire n’était pas une obligation qui devait s’imposer, car le recueil fait par les enquêteurs de l’AMF ne visait pas les explications de la personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause, ce recueil ayant lieu en amont d’une procédure de sanction ouverte par l’autorité ou d’une procédure pénale.
Enfin, les juges ont pu se prononcer dans la continuité de jurisprudences déjà établies sur la responsabilité pénale de la personne morale et le caractère indivisible de faits infractionnels de blanchiment. Ainsi par un arrêt du 4 mars 2025 n° 24-82.156, la chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle affirmé que la responsabilité pénale d’une personne morale pouvait être engagée par l’identification du représentant réel, même si un autre était mentionné dans l’acte de poursuite. Par un arrêt du 18 décembre 2024, n° 24-83.595, elle a confirmé que les opérations de placement initial des fonds sur un compte occulte et celles de réemploi de ces fonds sont considérées comme formant un tout indivisible, allongeant ainsi les délais de prescription en matière de blanchiment.