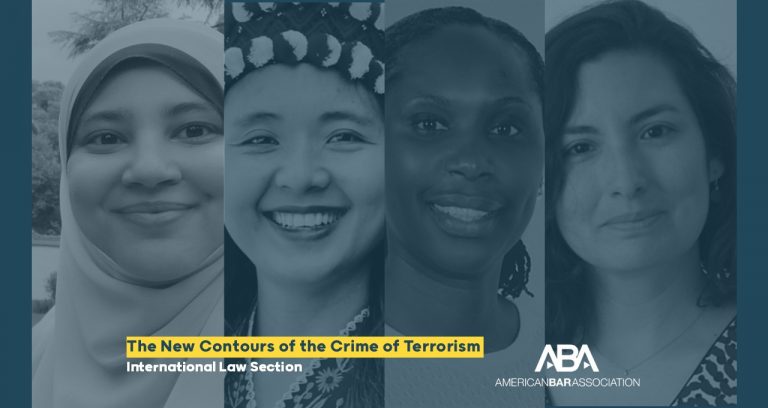Le développement des réseaux d’initiés, opérant de façon coordonnée sur les marchés financiers, compromettant de ce fait leur intégrité, fait partie des préoccupations majeures de l’Autorité des marchés financiers (“AMF”) et sur lequel elle alerte régulièrement. Ainsi notamment, le 9 juillet 2025, l’AMF et l’Agence française anticorruption (“AFA”) ont publié un appel à la vigilance commun pour alerter sur le risque de corruption privée par des réseaux criminels de personnes physiques ayant accès à des informations privilégiées[1].
Les recommandations conjointes de ces deux autorités étaient nombreuses et de plusieurs ordres. Elles visaient notamment à prévenir et détecter les risques de transmission d’informations privilégiées par les certaines catégories de personnes physiques susceptibles d’y avoir accès dans le cadre de leurs fonctions, de les former, mais également de formaliser des rappels de l’interdiction des opérations d’initiés dans des documents internes tels que des guides ou codes éthiques mais aussi de renforcer les politiques relatives aux cadeaux et invitations et de promouvoir les dispositifs d’alertes internes.
Ce faisant, l’AMF et l’AFA appelaient les entreprises, cotées notamment, à devenir des relais de la détection et de la prévention des risques liés aux opérations d’initiés.
Par ailleurs dans son rapport annuel pour 2024, l’AMF indiquait avoir observé, “dans le cadre d’enquêtes sur des faits d’abus de marché présumés, l’existence de véritables réseaux d’initiés s’organisant pour obtenir illégalement et de manière répétée des informations privilégiées concernant des sociétés cotées dans le but d’en tirer un profit sur les marchés financiers”, et poursuivait en indiquant avoir “préparé une série de dispositions législatives de nature à renforcer l’efficacité et l’efficience de son action répressive, notamment en vue de mieux lutter contre les réseaux d’initiés et les abus de marché, parfois adossés à l’activité de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, au crime organisé et au trafic de stupéfiants”[2].
Ces “dispositions législatives” ont désormais été relayées dans une proposition de loi présentée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025 par le député Daniel Labaronne qui appelle de ses vœux l’étoffement de l’arsenal de détection, de prévention, mais aussi de sanction de l’AMF. Ce député soulignait ainsi dans son rapport à l’Assemblée nationale que “pour rester à la hauteur de ses responsabilités, l’AMF doit sans cesse s’adapter”. Le message est clair : l’AMF a besoin de renforcer son action répressive pour faire face à la transformation de la délinquance financière.
La proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière présentée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025 qui rappelle les priorités et défis de l’AMF en matière répressive (I) vise à renforcer son efficacité autour de trois volets : lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques (II), simplification des procédures répressives (III) et évolution de la procédure devant la commission des sanctions de l’AMF (VI).
I. Les priorités de l’AMF et les défis rencontrés pour lutter contre la criminalité financière
Dans le cadre de la présentation du rapport annuel de l’AMF lors de son audition par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 25 juin 2025[3], Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de de l’AMF, a présenté les priorités du régulateur qui comptent notamment “l’adaptation de notre action de protection des investisseurs à un contexte qui se renouvelle très rapidement, ainsi que la poursuite du soutien à l’innovation et à la finance durable et la lutte contre l’insécurité financière. Cette dernière affecte les investisseurs par le biais des arnaques – qui est un phénomène massif – mais également les marchés financiers au travers de réseaux d’initiés internationaux”.
Cet impératif s’accompagnait d’une demande, formulée en ces termes : “L’AMF doit, en conséquence, disposer de pouvoirs juridiques renforcés pour mieux lutter contre cette criminalité financière”, et déclinée en un souhait d’obtenir des moyens juridiques supplémentaires pour visant à lutter contre “ l’expansion de réseaux internationaux qui se livrent au blanchiment de capitaux, sans doute issus de la criminalité organisée, voire du narcotrafic, au moyen de délits d’initiés sur les marchés de capitaux”[4].
Ce besoin de moyens supplémentaires est exprimé comme devant permettre à l’AMF d’assumer pleinement son rôle de régulateur de premier plan, garant de l’intégrité de la place de Paris. A cet égard Marie-Anne Barbat-Layani insistait sur l’action toujours plus soutenue de l’AMF qui “coopère aujourd’hui plus étroitement que jamais avec l’ensemble des acteurs financiers, et notamment, dans ce domaine, avec le parquet national financier (PNF). Nous utilisons à plein les mécanismes de coopération internationale qui existent au sein de nos instances internationales pour travailler avec les autres grands régulateurs de marché, notamment nos homologues américains et britanniques, qui constatent les mêmes phénomènes sur leur marché”[5].
Les préoccupations de l’AMF ont finalement été relayées par un groupe de députés qui, dans l’exposé des motifs de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière, rappelait que[6]:
“Ces dernières années, l’AMF a observé une évolution inquiétante : le développement de « réseaux d’initiés » liés à la criminalité organisée. Ces groupes s’organisent pour obtenir illégalement des informations privilégiées, qu’ils exploitent pour réaliser des transactions avant des annonces importantes (OPA, résultats financiers, etc.) ou qu’ils cèdent à des tiers, générant des gains conséquents. Ces pratiques portent gravement atteinte à l’intégrité et à l’efficience de la place financière française, fragilisant la confiance des investisseurs, notamment envers les sociétés cotées et leurs conseils juridiques et financiers.
La sophistication croissante des techniques utilisées – recrutement, traitement et transmission des informations, blanchiment des fonds – rend nécessaire l’adaptation des outils juridiques de l’AMF, pour mieux lutter contre les réseaux d’initiés et les abus de marché, parfois adossés à l’activité de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, au crime organisé et au trafic de stupéfiants.”
Les députés relevaient également le renforcement d’un deuxième “fléau” qui recouvre les “arnaques massives […] qui ciblent les investisseurs, amplifiées par le numérique et l’intelligence artificielle”, reprenant les chiffres communiqués par la présidente de l’AMF qui dénonce un véritable “phénomène de société” puisque “15 % des Français estiment avoir été victimes d’une arnaque financière ; le chiffre atteint 35 % chez les moins de 35 ans”.
La réponse à ces constats se veut triple :
- renforcer la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques ;
- simplifier les procédures répressives de l’AMF pour étendre son action ; et
- renforcer l’efficacité de la procédure devant la commission des sanctions de l’AMF.
II. Renforcer la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques
Le premier titre de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière a pour but de renforcer la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques autour de plusieurs axes : un accès plus large à certaines informations, un renforcement des liens entre l’AMF et l’autorité judiciaire et enfin – et surtout – la mise en place d’un dispositif de clémence.
La proposition de loi propose également, dans son article 5, de tirer les conséquences législatives de la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2022 (n°2021-965 QPC) rendue sur le fondement du principe non bis in idem s’agissant du manquement d’entrave aux enquêtes et contrôles de l’AMF et du délit d’entrave, qui font à ce jour l’objet de fondements distincts dans le code monétaire et financier. Cet article propose de limiter le périmètre du délit d’entrave aux entraves constatées dans les enquêtes portant sur des faits d’abus de marché et, afin de prévenir le cumul de poursuites, de soumettre les faits susceptibles d’être qualifiés d’entrave au même processus d’aiguillage formalisé que celui existant aujourd’hui pour les faits d’abus de marché.
A. Un accès étendu de l’AMF à certaines informations et techniques de collecte de données
L’article 1er de la proposition de loi permettrait à l’AMF d’accéder, de manière automatisée et non plus uniquement manuelle, à des contenus publiquement accessibles sur les plateformes en ligne, communément appelé moissonnage de données ou “web scraping” afin de les exploiter dans le cadre d’enquêtes portant sur des abus de marché. Son article 2 vise à permettre d’étendre cet accès pour assurer les missions de surveillance de l’AMF et de veille sur les produits et services financiers illicites, y compris en matière de cryptoactifs.
Si le web scraping n’est en soi pas prohibé de façon générale, la CNIL appelle à la vigilance et à la proportionnalité dans son usage ce qui la conduit à considérer que cette pratique est interdite en l’absence d’encadrement juridique lorsque les traitements sont mis en œuvre par des autorités compétentes à des fins de détections d’infraction[7]. Ainsi à moins d’être encadré par un texte normatif, le web scraping ne peut être une technique d’enquête. La proposition de loi vise à doter les enquêteurs et contrôleurs de l’AMF d’une telle technique.
Ces deux dispositions sont proposées “à titre expérimental” pour une durée de cinq ans, cette expérimentation devant faire l’objet d’un bilan transmis au Parlement ainsi qu’à la CNIL avant sa pérennisation éventuelle.
L’extension des moyens permettant à l’AMF de recueillir des éléments susceptibles d’étayer la commission de certains manquements concerne également l’usage d’une identité d’emprunt. Si cette faculté est déjà prévue par l’article L. 621-10-1 du code monétaire et financier pour les enquêteurs et les contrôleurs de l’AMF afin de documenter la façon dont un service est rendu par une autorité régulée, l’article 3 de la proposition de loi vise à l’étendre afin de mieux identifier les offres financières illicites (mission de veille) et de mieux détecter les abus de marché (dans le cadre des missions de surveillance et d’enquête).
B. Un renforcement des liens entre AMF et autorité judiciaire en matière de communication de preuves
L’article 4 de la proposition de loi permet au procureur de la République financier et aux juges d’instruction de saisir (pour ces derniers par voie de commission rogatoire) les enquêteurs de l’AMF, spécialement habilités à cet effet, dans le cadre d’enquêtes pénales pour abus de marché. Si cela constitue certainement une innovation procédurale, la pratique existait auparavant pour les juges d’instruction de demander, par voie de réquisitions, l’assistance d’enquêteurs de l’AMF au cours d’interrogatoires ou d’auditions.
Comme le rappelle l’exposé des motifs, cette mesure s’inspire de celle qui existe pour les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l’Autorité de la concurrence[8]. Ce dispositif est proposé à titre expérimental, pour une durée initiale de trois ans devant faire l’objet d’une première évaluation avant d’envisager sa pérennisation.
L’article 6 de cette proposition suggère en outre d’étendre à tous les parquets la faculté de transmettre à l’AMF des pièces de la procédure pénale (procès-verbaux, rapports, etc.) ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à la commission des sanctions de l’AMF. Cette faculté existe aujourd’hui au bénéfice du seul Parquet national financier, qui dispose de canaux de coopération privilégiés avec l’AMF résultant de leurs domaines de compétences très proches.
C. La création d’un dispositif de clémence, une innovation devant permettre un renforcement de la lutte contre les réseaux d’initiés
Sans doute l’une des innovations les plus marquantes – et attendue par certains – de cette proposition de loi, son article 7 crée un dispositif de clémence en matière d’abus de marché et d’offres au public de titres financiers irréguliers.
La clémence envisagée se manifeste par une exemption totale ou une réduction de sanction, qui peut être accordée par la commission des sanctions aux personnes ayant apporté à l’AMF des éléments dont elle ne disposait pas antérieurement et qui contribuent à identifier des personnes impliquées ou à établir des manquements susceptibles d’être sanctionnés. Cette clémence a vocation à se déployer dans le cadre des affaires ressortissant de la compétence de la commission des sanctions de l’AMF, mais également dans le cadre de l’action pénale. La proposition de loi ne détaille pas les niveaux de réduction ni les rangs éventuels qui pourront être attribués aux demandeurs à la clémence qui pourront être détaillés ensuite dans le règlement général de l’AMF ou encore dans une procédure spécifique.
Ainsi, c’est une incitation très forte au repentir et à la coopération qui est proposée, de façon inédite pour l’AMF alors qu’aujourd’hui la coopération avec l’autorité n’est valorisée que marginalement et de façon peu transparente, en tant que facteur pouvant être pris en compte par la commission des sanctions pour moduler le montant des sanctions prononcées[9].
L’Autorité de la concurrence, qui dispose de ce mécanisme de longue date et dont la proposition de loi s’inspire largement, le qualifie de “puissant facteur de déstabilisation des cartels”[10], ou ici des réseaux d’initiés.
En conclusion cette disposition, si elle est adoptée, devrait également permettre aux sociétés notamment de réagir plus volontiers aux alertes, signalements ou suspicions pouvant leur être remontés et, le cas échéant, d’adopter une démarche spontanée et proactive de recherche de manquement en ayant recours à des enquêtes internes par exemple.
III. La simplification des procédures répressives de l’AMF en vue d’étendre son action
Les innovations procédurales portées par la proposition de loi du 16 septembre 2025 visent à permettre à l’AMF une action répressive plus large, plus efficace et plus dissuasive.
L’article 8 de cette proposition de loi crée un mécanisme de “transaction simplifiée” qui fait écho à la “composition administrative” prévue à l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier qui permet au Collège de proposer une résolution négociée de la procédure d’enquête ou de contrôle, en contrepartie d’engagements pécuniers et/ou de remédiation. La procédure de composition administrative est encadrée dans des délais relativement brefs, et concerne en général les dossiers pour lesquels la preuve des manquements est fermement établie, sans complexité majeure ou sans enjeu jurisprudentiel ou encore qui concernent un nombre d’intervenants limité.
A la différence de la composition administrative, la “transaction simplifiée” se positionne en amont même de toute enquête ou de tout contrôle. Elle serait dédiée aux manquements déclaratifs sans gravité et concernerait tant les personnes physiques que morales. Cette transaction simplifiée pourrait être proposée à l’initiative du secrétaire général de l’AMF en contrepartie du règlement par la personne concernée d’un montant maximum de 30 000 euros. Si cette somme est relativement limitée, le texte proposé est silencieux quant au traitement des manquements répétés ou continus.
L’objectif de cet outil est de permettre à l’AMF d’appréhender certains manquements qui, au regard de leur faible gravité et de l’opportunité d’allocation de ses ressources, ne faisaient le plus souvent l’objet d’aucune suite malgré leur détection.
L’article 9 de la proposition de loi vise à renforcer le pouvoir d’injonction du Collège de l’AMF qui est prévu au II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier en application duquel cet organe peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin aux manquements constatés. La proposition de loi envisage que ce pouvoir d’injonction administrative soit assorti d’une astreinte, à l’instar de ce qui existe pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou l’Autorité de la concurrence. En effet, l’exposé des motifs de la proposition de loi constate que “il est apparu que l’absence d’astreinte était de nature à compromettre l’efficacité des mesures administratives que le collège de l’AMF pouvait être amené à prendre, en particulier dans l’urgence, afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés et de faire respecter la règlementation financière. La faculté d’assortir l’injonction administrative prononcée d’une astreinte, lorsque la situation s’y prête, sera de nature à rendre ce pouvoir plus dissuasif.”.
L’article 10 de la proposition de loi, qu’il conviendra d’articuler avec le nécessaire respect de la présomption d’innocence, vise à permettre à l’AMF de communiquer sur des procédures d’enquête, de contrôle ou de sanctions en cours afin de lui permettre d’attirer l’attention d’investisseurs sur le “caractère illicite” de certains produits financiers ou de rectifier des informations ayant pu être révélées dans les médias sur des procédures en cours. En l’état, cette faculté de communication serait conditionnée “soit par un impératif d’information des investisseurs, de bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ou de protection de l’épargne investie dans les instruments financiers soit pour éviter ou mettre fin à la propagation d’informations parcellaires ou inexactes”.
Cet article ne prévoit toutefois, en l’état, pas de recours contre cette communication potentiellement attentatoire à la réputation des personnes qui en feront l’objet.
L’article 11 de la proposition vise à renforcer le dispositif de visites domiciliaires réalisées par les enquêteurs de l’AMF prévu à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier. En application de ce texte, les éléments susceptibles d’être saisis par les enquêteurs de l’AMF ne seraient ainsi plus limités aux “documents” mais étendus à “tout support d’information et, le cas échéant, leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles”. Cet article simplifie également les modalités de désignation et de participation des officiers de police judiciaire aux visites domiciliaires. Enfin, dans l’hypothèse où des opérations de visites et saisies réalisées par l’AMF seraient annulées par le premier président de la cour d’appel, et afin d’éviter un risque de déperdition des preuves, l’article prévoit que les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue, c’est‑à‑dire jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation, lorsque celui‑ci est formé, comme le souligne son exposé des motifs.
Enfin, l’article 12 de la proposition de loi comprend une autre innovation majeure : la faculté pour le secrétaire général de l’AMF d’imposer aux entités régulées la réalisation d’audits externes afin de s’assurer du respect de la réglementation applicable. Cet article, qui aurait vocation à s’inscrire dans la sous-section intitulée “veille et surveillance” de la section du Code monétaire et financier détaillant les pouvoirs de l’AMF, prévoit que cet audit pourra être réalisé par “un prestataire indépendant dont il valide le choix. L’objet précis de l’audit est indiqué par écrit au professionnel. Le coût de l’audit est supporté par le professionnel”. L’exposé des motifs de cette proposition de loi fait une référence directe à la pratique de la Financial Conduct Authority britannique, qui permettrait dans un certain nombre de cas d’éviter l’ouverture de procédures de contrôle et d’accélérer la mise en œuvre des mesures de remédiation.
La proposition de loi ne délimite pas la notion de “prestataire indépendant”, qui pourrait dès lors être un auditeur, un expert forensique ou encore un cabinet d’avocats ce qui permettrait aux entreprises concernées de bénéficier du secret professionnel.
Cette faculté laissée à l’appréciation du secrétaire général de l’AMF semble extrêmement large, dans la mesure où le texte ne prévoit en l’état aucun critère permettant de déclencher une telle demande d’audit, tel que des suspicions graves de manquements, des plaintes répétées d’investisseurs, etc.
Par ailleurs, la demande de mettre en œuvre un tel audit, et le partage de ses conclusions avec le régulateur, devra également être confrontée au droit de ne pas s’auto-incriminer.
IV. Le renforcement de l’efficacité de la procédure devant la commission des sanctions de l’AMF
Le dernier volet de la proposition de loi concerne directement la procédure devant la commission des sanctions, devant lui permettre de mieux individualiser les sanctions prononcées, de bénéficier d’un élargissement du panel de sanctions à sa disposition et étend les facultés de recours contre ses décisions.
L’article 13 de la proposition de loi octroierait la possibilité au rapporteur de la commission des sanctions la possibilité de demander directement à l’administration fiscale des éléments relatifs à la situation patrimoniale des mis en cause alors que, à ce jour, la pratique consistait pour le rapporteur à interroger les mis en cause à cet égard en leur proposant de transmettre des éléments attestant de leur patrimoine dont l’exhaustivité ne pouvait être vérifiée. Cet article ne permettrait toutefois pas au rapporteur d’obtenir, dans les faits, d’éléments sur le patrimoine extraterritorial des mis en cause, notamment lorsque ceux-ci sont des résidents étrangers.
L’article 14 de cette proposition vient compléter l’éventail des sanctions que peut prononcer la commission des sanctions de l’AMF en y ajoutant l’interdiction, pour une durée maximum de dix ans, d’exercer un mandat social au sein d’une société cotée et de négocier des instruments financiers pour compte propre.
L’article 15 de cette proposition devrait en outre étendre la compétence de la commission des sanctions en matière d’offres au public irrégulières, cette compétence étant aujourd’hui principalement limitée aux offres portant sur des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives constituées sous forme de société anonyme.
Enfin, l’exposé des motifs de cette proposition de loi indique que son article 16 vise à mettre fin à l’asymétrie selon laquelle seul le président de l’AMF peut effectuer un recours incident lorsque la personne sanctionnée a elle-même introduit un recours principal à l’encontre d’une décision de la commission des sanctions. Il est ainsi proposé qu’en cas de recours principal introduit par le président de l’AMF à l’encontre d’une décision prononcée par la commission des sanctions, la personne sanctionnée puisse également avoir la faculté d’effectuer un recours incident afin de contester les griefs retenus à son encontre et le montant de la sanction, dans les mêmes délais que ceux qui bénéficient au Président de l’AMF pour former un recours incident. Il convient toutefois de relever que les recours incident du Président de l’AMF ne sont pas fréquents, aucun recours incident n’ayant été recensé en 2024 et seuls deux l’ont été en 2023.
*
En conclusion, l’appel de l’AMF à la Commission des finances de l’Assemblée nationale visant à obtenir des moyens supplémentaires a manifestement été entendu.
Pour certaines ambitieuses et innovantes, ces mesures permettraient un renforcement certain et une plus grande efficacité de l’action répressive de l’AMF mais aussi une évolution des procédures judiciaires dans les dossiers d’abus de marché. On peut retenir, et saluer, en particulier le dispositif de clémence qui, on l’espère, permettra à l’AMF d’évoluer vers un dialogue plus approfondi avec les personnes faisant l’objet d’enquêtes notamment.
Cette proposition de loi n’aura toutefois pas été l’occasion de renforcer la place des droits de la défense qui demeurent discrets dans la procédure AMF. En effet l’accroissement des pouvoirs de l’AMF n’est pas envisagé comme devant s’accompagner d’une évolution des droits d’accès aux dossiers d’enquête, très tardifs en l’état de la procédure, ou des délais de réponse au rapport du rapporteur. Enfin, alors que la panoplie de sanctions est amenée à évoluer, la proposition de loi est silencieuse sur les critères de détermination du montant des sanctions pécuniaires et sur la quantification des facteurs majorants et minorants, pourtant déjà largement développés chez les homologues étrangers de l’AMF ou autres régulateurs dont elle s’inspire.
L’évolution de cette proposition sera donc à suivre avec attention…