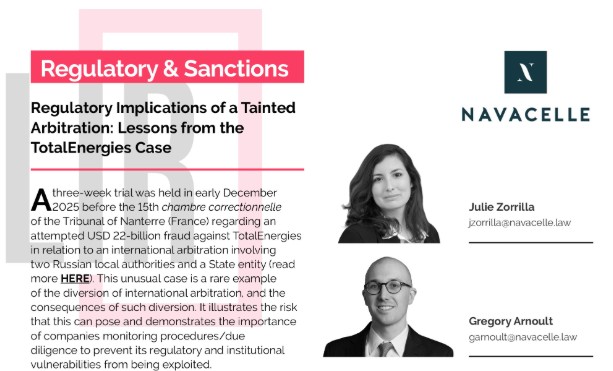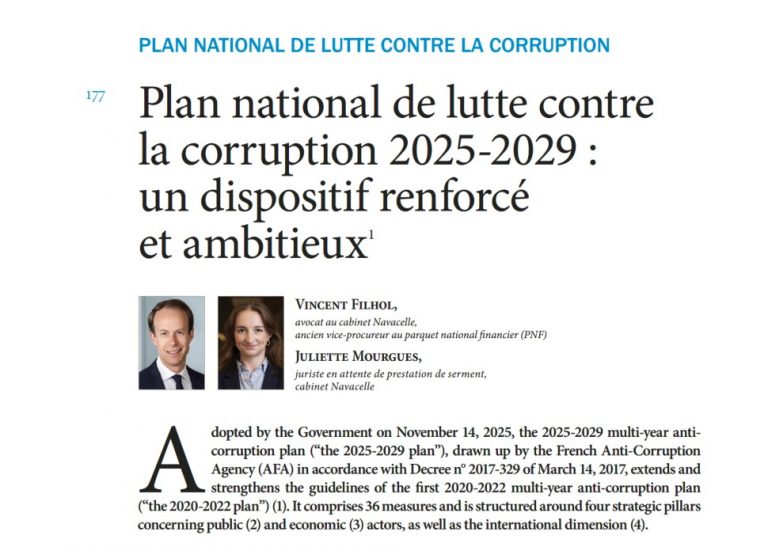La lutte contre le greenwashing a connu un nouveau tournant fin octobre 2025[1]. Pour la première fois d’après les associations qui l’avaient saisie, la justice française a estimé que les déclarations en ligne d’un grand groupe pétro-gazier, vantant ses engagements environnementaux, étaient susceptibles d’être de nature à tromper les consommateurs sur la portée réelle de ces engagements.
En effet, par une décision rendue le 23 octobre 2025, la 34ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France de mettre fin à la diffusion sur le site internet du groupe, d’une publication présentant l’entreprise comme un “acteur majeur de la transition énergétique” et affirmant “son ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050”.
Cette décision a été prononcée à la suite d’un recours introduit par les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre contre des sociétés du groupe TotalEnergies. Les demanderesses reprochaient au groupe d’avoir diffusé, lors d’une campagne de communication lancée en 2021 pour présenter sa nouvelle stratégie énergétique, des messages trompeurs sur ses engagements environnementaux. Elles ont saisi le tribunal sur le fondement des articles L.121-1 à L.121-3 du code de la consommation[2] relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et en réparation du préjudice écologique de ses activités sur l’atmosphère.
Cette décision, dont le groupe Total a indiqué ne pas vouloir interjeter appel[3], illustre d’une part la reconnaissance des pratiques commerciales trompeuses liées à l’environnement (I) et, d’autre part, les difficultés juridiques persistantes soulevées par ce type de contentieux (II).
I. La reconnaissance des pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale
En droit de la consommation, les pratiques commerciales déloyales, et en particulier trompeuses, sont interdites[4]. L’objectif des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, issus de la Directive 2005/29/CE[5], est de protéger les consommateurs contre toute communication susceptible de les tromper, qu’il s’agisse d’“allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur […] notamment sur [l’]impact environnemental” d’un bien ou d’un service ou par omission ou dissimulation d’informations de nature à induire le consommateur en erreur[6].
Progressivement, ces règles de droit de la consommation ont servi de cadre permettant de sanctionner les allégations, indications ou encore présentations trompeuses liées à l’environnement. Cette tendance a été davantage renforcée par la Directive (UE) 2024/825[7] qui qualifie les allégations environnementales trompeuses d’“écoblanchiment” (“greenwashing”), et définit les grands principes permettant de protéger les consommateurs et de leur garantir la possibilité de faire des choix réellement durables.
Dans ce contexte, la décision rendue le 23 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris illustre la protection offerte par le droit de la consommation contre l’écoblanchiment. Après avoir mentionné la Directive précitée de 2024, son absence de transposition au jour de sa décision et indiqué qu’il ne saurait interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre les objectifs poursuivis par ce texte communautaire[8], le tribunal a jugé que les informations publiées par TotalEnergies sur son site internet, présentant son “ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique”[9] œuvrant pour la neutralité carbone d’ici 2050, étaient susceptibles d’altérer “de manière substantielle, le comportement économique d’un consommateur normalement attentif et avisé”[10] et le laisser “croire, qu’en achetant ses produits ou ses services, il participait à l’émergence d’une économie à faible intensité”[11]. La décision souligne également que la poursuite de investissements du groupe dans le pétrole et le gaz du groupe sont “à rebours” des objectifs fixés par les Accords de Paris[12].
Sur la base de ces constatations, le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France pour pratiques commerciales trompeuses. Les sociétés ont été sommées de mettre fin à la diffusion en ligne des allégations litigieuses et de publier la décision judiciaire pendant 180 jours sur leur site internet. Le jugement a par ailleurs accordé aux trois associations demanderesses des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral[13].
II. Les obstacles juridiques persistants en matière de contentieux climatique
La première difficulté mise en évidence par ce jugement est la portée limitée des articles L.121-1 à L.121-3 du code de la consommation. Pour qu’une pratique puisse être qualifiée de trompeuse au sens de ces dispositions, elle doit impérativement relever d’une activité commerciale.
Dans l’affaire TotalEnergies, les associations demanderesses avaient notamment souligné que le groupe présentait le gaz fossile et certains agrocarburants comme des énergies peu polluantes, en utilisant un vocabulaire proche de celui des énergies renouvelables, contribuant ainsi à induire en erreur le consommateur sur la nature réelle de ces produits.
Sur ce point, le tribunal a toutefois estimé que ces allégations relevaient d’une communication d’information et n’étaient pas directement liées à “la promotion, la vente et la fourniture d’énergie aux consommateurs”[14]. Qu’elles soient trompeuses ou non, ces informations ne sont donc pas considérées par le tribunal comme commerciales et échappent au champ de protection du code de la consommation.
Une seconde difficulté ressort du jugement du 23 octobre 2025 : les associations avaient également demandé la réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile. Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, il est possible d’engager la responsabilité de toute personne ayant causé un préjudice écologique[15]. Cependant, démontrer le lien de causalité entre les activités du groupe et un tel préjudice reste extrêmement complexe, ce qui explique que cette demande n’ait pas été accordée.
A cet égard, le tribunal a rappelé que le préjudice écologique invoqué par les associations ne pouvait ouvrir droit à réparation. Les communications du groupe Total sur les avantages de l’exploitation de gaz fossiles et d’agro-carburants étaient considérées comme des informations sur les projets du groupe et non comme des messages directement liés à la vente de produits[16]. En conséquence, les demanderesses n’ont pas été en mesure de démontrer que ces communications étaient de nature à inciter les consommateurs à privilégier des énergies fossiles, causant ainsi une atteinte à l’atmosphère.
La question de la preuve reste donc un enjeu majeur, limitant les chances de succès de certaines actions, notamment lorsqu’il s’agit de l’impact réel des communications environnementales sur le comportement des consommateurs ou sur l’environnement.